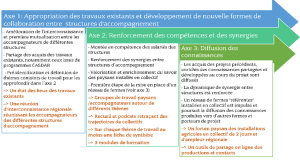Un enjeu fort de renouvellement des générations agricoles :
- En Occitanie, en 2019, 41 % des chefs d’exploitations avaient plus de 55 ans, et la majorité d’entre eux n’a pas de repreneur connu à ce jour. Les installations ne suffisent pas à remplacer les départs. Au cours des dix dernières années, pour 100 agriculteurs qui ont cessé leur activité, on comptait en moyenne seulement 63 installations. En 2017 dans la région, 3 564 chefs d’exploitation (CE) ont cessé leur activité quand 1 552 nouveaux CE se sont installés. Le nombre de candidats à l’installation poussant les portes des Point Accueil Installation ne cesse pourtant d’augmenter (ils étaient 3100 en 2017). Ce déficit d’installations engendre de nombreux problèmes qui s’opposent à plusieurs des principes de l’agroécologie : une perte de foncier agricole du fait de l’urbanisation ou de la spéculation foncière, un rachat des terres cédées par les fermes existantes qui contribue à l’agrandissement et l'intensification des exploitations agricoles.
- Nombreux sont les candidats à l'installation qui abandonnent leur projet faute de capital suffisant pour racheter les fermes existantes ou parce que les modèles de production, les contraintes d’organisation ou l’isolement de ces fermes ne correspondent pas à leurs envies. L’installation agricole en collectif constitue une solution à ces blocages. Lors de l’élaboration de leur Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP), 48% des porteurs de projet d’Occitanie envisagent une installation en association (contre 21% lors de leur premier passage en Point Accueil Installation). À l’échelle régionale, « l’agriculture de groupe » (agriculteurs engagés dans une exploitation sociétaire dirigée par plusieurs personnes) concerne 18 257 CE et 8 256 exploitations, soit 31% des CE et 715 des nouveaux CE installés en 2017 (38%).
- L’installation agricole sous forme sociétaire se développe depuis plus de 40 ans et n’est pas un phénomène nouveau. En revanche, les professionnels de l’installation constatent, depuis une dizaine d’années, une recrudescence et une évolution des projets d’installation collective entre tiers.
Des projets agricoles en collectif multi-performants, porteurs d’innovations techniques, économiques, et organisationnelles :
Ces projets ont des formes très variables : sociétés agricoles classiques GAEC, EARL, SCEA, mais aussi SCOP, entraide, banques de travail, coopératives de production, associations agricoles, etc. Ils sont pour beaucoup menés par des groupes de plus de deux personnes, qui s’installent généralement hors cadre familial (HCF). La dimension collective est une valeur fondatrice de leur projet ; ils le construisent ensemble avec des objectifs professionnels définis et négociés en amont de l’installation.
Ces nouvelles formes de fermes installées en collectif constituent une opportunité pour faire face à plusieurs enjeux du renouvellement des générations agricoles et de la durabilité des systèmes d’exploitation agricoles :
- La reprise effective de structures de production conventionnelles difficilement transmissibles (grandes surfaces, fort capital), grâce à la mutualisation des coûts d’investissement et d’exploitation ;
- L’augmentation de la valeur ajoutée produite sur le territoire, notamment par le développement d’ateliers de transformation, l’accueil à la ferme ou la commercialisation en circuit court, plus facilement envisageables lorsque la charge de travail et les compétences mobilisées sont réparties entre plusieurs associés ;
- Le développement de nouveaux systèmes de production diversifiés, multi-performants et économes en intrants : l'installation à plusieurs sur une ferme à capitaux importants ou grande surface permet une réorientation des systèmes de production, en créant de nouveaux ateliers (et en développant des complémentarités agronomiques), en adoptant des techniques de production plus exigeantes en main d’œuvre et moins consommatrices en intrants chimiques, en s’appuyant sur l’intelligence collective comme vecteur d’innovation. Tous ces changements seraient difficiles à mettre en œuvre en étant seul, tant ils impliquent une augmentation de la charge de travail et une démultiplication des compétences mobilisées ;
- L’amélioration des conditions de vie et de travail des paysans par le partage de l’astreinte, des risques et de la charge mentale, la rupture de l’isolement quel que soit le lieu d’installation, l’investissement dans la vie associative ou politique locale, l’ancrage territorial, etc. ;
- La résilience des exploitations par le renouvellement progressif des membres du groupe, dans un contexte où les carrières agricoles sont de plus en plus courtes. Le taux de remplacement des CE en agriculture de groupe est ainsi supérieur au taux de remplacement moyen (79% contre 63% en 2017).
Des besoins d’accompagnement spécifiques :
- L’installation en collectif est particulièrement performante pour répondre aux enjeux précités mais elle implique l’anticipation de difficultés inhérentes à la dimension collective des projets et à la restructuration des fermes reprises.
- L’anticipation et la gestion des multiples difficultés humaines liées au collectif sont des défis centraux pour la pérennité de ces initiatives, qui s’ajoutent aux exigences de l’activité agricole (Morel, 2018). Une multitude de choix s’offre à ces collectifs : concernant leurs statuts juridiques, leurs modalités d’accès au foncier, pour la structuration de leurs activités économiques, dans les modes d’allocation des espaces et des ressources, dans leur organisation du travail et dans leurs dispositifs de gouvernance.
- Les facteurs de succès ou d’échecs des projets collectifs en agriculture sont à analyser. Mais aucun dispositif multi-partenarial innovant ne le permet aujourd’hui. L’enrichissement des connaissances, des méthodes d’accompagnement et le développement de nouveaux outils sont donc à consolider. Du fait de la grande hétérogénéité des projets en collectif, ce n’est pas une mais des méthodes d’accompagnement qui doivent être développées pour s’adapter le mieux possible à chaque situation.